Alors que la participation et la démocratie en santé s'imposent progressivement comme des piliers essentiels de l'accompagnement des personnes, la question du pouvoir d'agir, tant des managers que des collaborateurs, devient centrale.
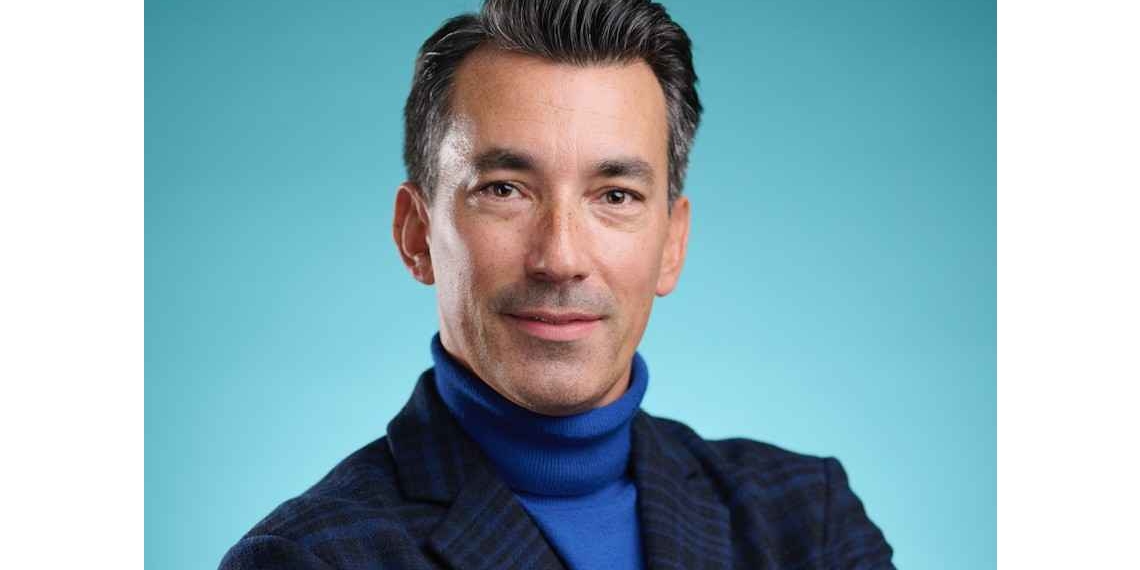
 Reconnaissance et libération du pouvoir d'agir : clé des organisations bientraitantes
Reconnaissance et libération du pouvoir d'agir : clé des organisations bientraitantes
- Par Johan Girard

Cet article est réservé aux abonnés.
Pour profiter pleinement de l'ensemble de ses articles, Géroscopie vous propose de découvrir ses offres d'abonnement.
Sa reconnaissance au sein des organisations est aujourd'hui un enjeu majeur pour renforcer non seulement l'efficacité des services mais aussi l'attractivité des métiers dans les établissements et services pour personnes âgées.
La place du management pour une organisation libérée
Les modèles tayloristes ont longtemps structuré les organisations autour de rôles délimités et de processus standardisés. Bien que ces systèmes aient permis des gains en efficacité, ils ont aussi engendré des paradoxes : des injonctions contradictoires et une perte de sens pour les professionnels. Cette contextualisation a été rappelée dans le cadre du rapport de Myriam El Khomri (2019) dénommé Plan de Mobilisation Nationale en faveur de l'attractivité des métiers du grand âge. Ces méthodes peuvent être à l'origine d'une rigidité organisationnelle freinant l'innovation, l'autonomie, et, in fine, la qualité du service rendu aux personnes accompagnées. La libération du management consiste à inverser cette logique en reconnaissant et en valorisant le potentiel d'action et de décision à tous les niveaux de l'organisation.
Cette approche repose sur une double dynamique :
La reconnaissance du pouvoir d'agir des managers : En leur accordant davantage de marge de manoeuvre, ils peuvent jouer un rôle de facilitateur auprès de leurs équipes. Le manager ne se limite plus à un rôle opérationnel ou de contrôle, mais devient un véritable acteur de transformation organisationnelle. Cependant, dans des systèmes organisationnels de groupes de plus ou moins grandes tailles, cette reconnaissance peut se heurter à des freins structurels. Ils peuvent être imposés par des cadres hiérarchiques stricts tendant vers une modélisation de pratiques comme dans le cadre d'un management des risques ou être influencés par des orientations données par les autorités telles que les ARS ou les conseils départementaux (CD). Ces instances, bien que nécessaires pour garantir une cohérence et une régulation des pratiques, peuvent parfois limiter l'autonomie managériale en imposant des directives ou des protocoles rigides. Dès lors, il devient essentiel d'engager l'ensemble des parties prenantes dans une démarche de confiance mutuelle et de co-construction pour permettre aux managers d'exercer pleinement leur rôle stratégique et opérationnel et créer les conditions du développement du pouvoir d'agir en ruissellement auprès de tous leurs collaborateurs
Le renforcement du pouvoir d'agir des collaborateurs : Les équipes, reconnues pour leurs compétences et leur expertise terrain, sont encouragées à proposer, à co-construire et à innover. Le rôle du manager est ici crucial : en instaurant un cadre de confiance, il favorise une reconnaissance explicite des compétences et des initiatives de ses collaborateurs. Ce processus implique :
La valorisation des compétences individuelles et collectives : En reconnaissant les talents spécifiques des membres de l'équipe, le manager leur permet de se sentir légitimes dans leurs actions et d'oser proposer des solutions innovantes.
Un cadre propice à la responsabilisation : En clarifiant les objectifs, les rôles et les marges de manoeuvre, le manager encourage une prise d'initiative autonome. Cette responsabilisation renforce non seulement la confiance mutuelle mais aussi l'engagement des collaborateurs.
Une dynamique d'encouragement et de feedback constructif : Le soutien actif du manager, à travers un retour régulier sur les réussites et les axes d'amélioration, contribue à renforcer le sentiment de reconnaissance et d'accomplissement des collaborateurs.
Ce cercle vertueux de confiance et de responsabilisation permet aux collaborateurs de développer leur capacité à agir dans un système souvent contraint. En se sentant reconnus pour leur expertise et soutenus dans leurs initiatives, ils gagnent en assurance et en autonomie, ce qui se traduit par une meilleure qualité du service rendu aux personnes accompagnées.
Le pouvoir d'agir : une question de reconnaissance
La reconnaissance est au coeur de cette transformation. Reconnaître le pouvoir d'agir signifie non seulement donner la capacité de prendre des initiatives, mais aussi valoriser les résultats obtenus. Pour ce faire, les organisations doivent :
- Développer des espaces de dialogue et de participation afin que les collaborateurs et les managers puissent exprimer leurs idées et expérimenter de nouvelles pratiques.
- Favoriser une gouvernance partagée, qui valorise la contribution de chacun dans la décision collective.
- Investir dans des formations pour renforcer les compétences en leadership, en gestion de projet et en décision autonome.
L'impact sur les personnes accompagnées
Ce modèle participatif ne se limite pas à l'interne. En renforçant le pouvoir d'agir des équipes, les organisations créent les conditions favorables à une meilleure qualité de service pour les personnes accompagnées. Ces dernières bénéficient d'un accompagnement plus adapté, plus humain, et davantage personnalisé, en cohérence avec les principes de la démocratie en santé.
Une responsabilité collective
Libérer le management est un chantier ambitieux, mais nécessaire. Il repose sur une responsabilité collective où chaque acteur, qu'il soit dirigeant, manager ou collaborateur, doit être reconnu comme un maillon essentiel. Dans un secteur en pleine mutation, notamment pour les établissements et services à destination des personnes âgées, cette évolution est un levier pour bâtir des organisations bientraitantes, au service des personnes et de ceux qui les accompagnent.

